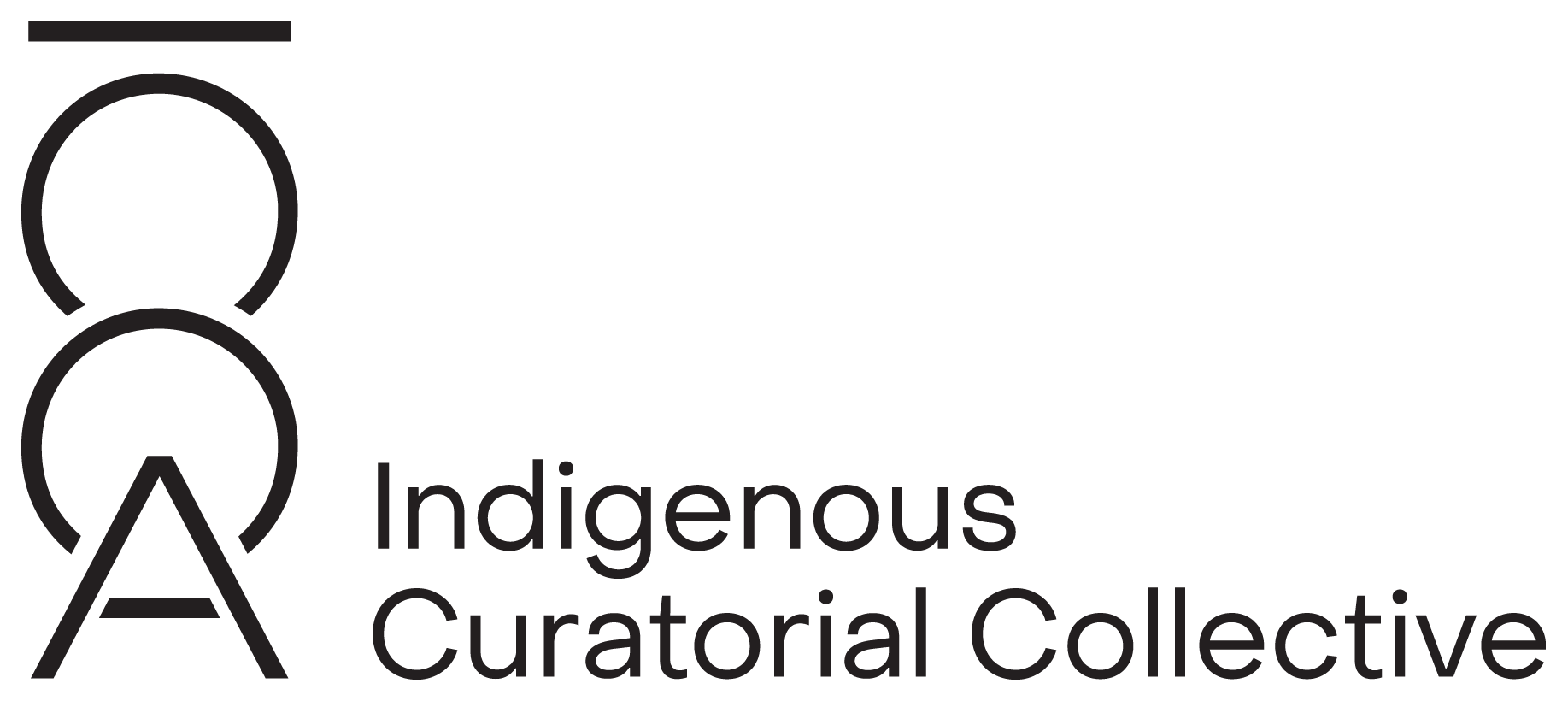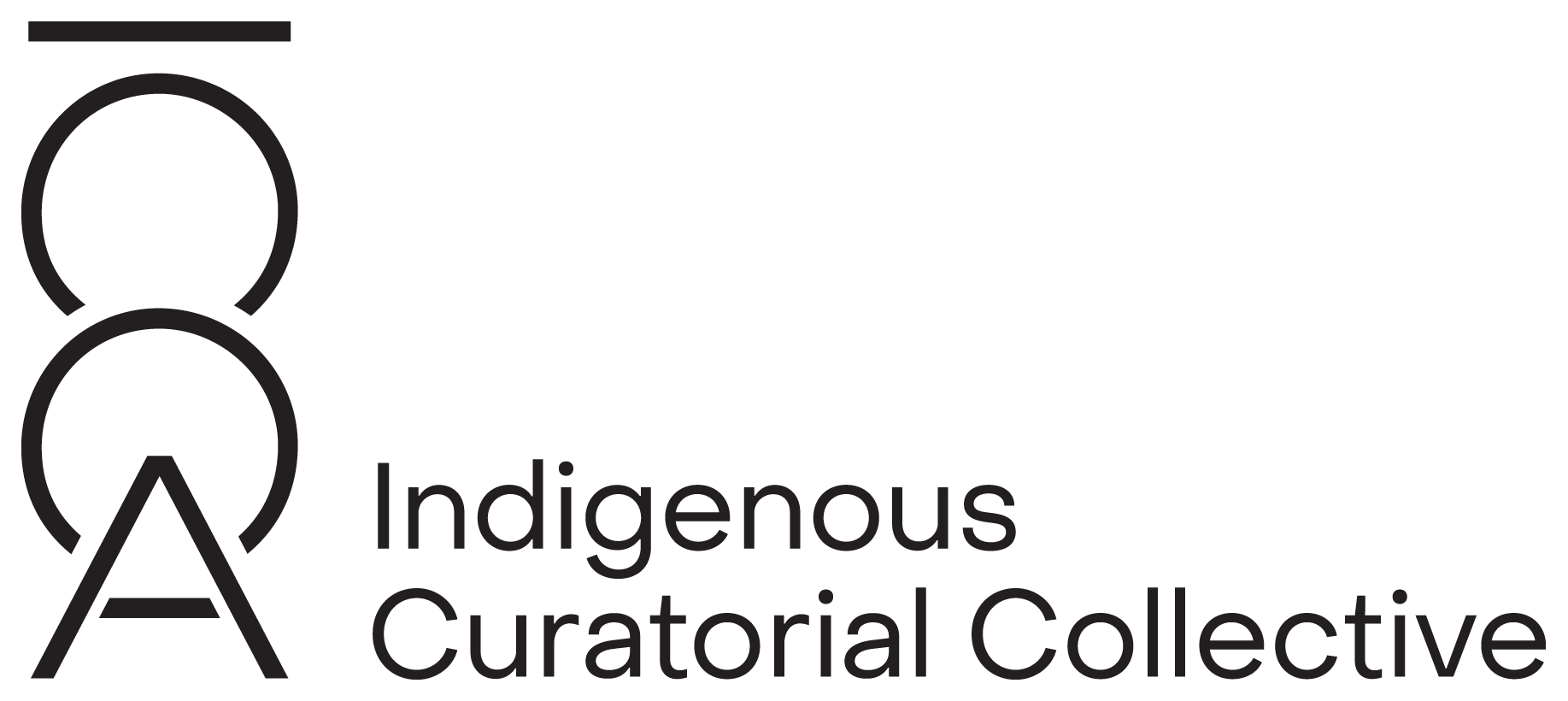UNCEDED: Terres en récit
Biennale de Venise en architecture 2018, du 26 mai au 25 novembre 2018
Architecte principal : Douglas Cardinal
Commissariat : David Fortin et Gerald McMaster
par Jason Baerg
L’architecture autochtone ne s’oriente pas autour d’objets. L’année 2018 est historique pour le Canada à Venise. Les rénovations du pavillon canadien du Giardini della Biennale terminées, celui-ci a rouvert ses portes au public lors du lancement de la Biennale. Le pavillon nécessitait une restauration après presque soixante ans d’existence. Compte tenu des travaux, il n’était pas disponible pour y préparer le projet de la Biennale d’architecture. L’exposition canadienne s’est donc déroulée à l’Arsenale. Fait encore plus marquant, la présentation canadienne de 2018 se démarque comme la première exposition menée par des architectes autochtones. Cette réalisation, conçue par une grande équipe d’architectes autochtones, s’intitule UNCEDED: Terres en récit. Elle met de l’avant Douglas Cardinal (Blackfoot) comme architecte et présentateur principal tandis que les commissaires David Fortin (Métis) et Gerald McMaster (Blackfoot et Cri) l’ont appuyé dans ce rôle. La majorité des gens ignorent que le Canada demeure, à ce jour, un projet colonial fondé sur un ensemble de rapports complexes avec des peuples autochtones souverains et leurs ressources naturelles. L’exposition vise à remédier à ce manque de sensibilisation.
Un esprit de générosité imprègne l’équipe d’architectes de l’Île de la Tortue (le nom du territoire que les sociétés coloniales appellent aujourd’hui l’Amérique du Nord ou le Canada et les États-Unis). Avec vingt doctorats honorifiques, Douglas Cardinal jouit d’une renommée internationale pour ses contributions conceptuelles et formelles à l’architecture; son œuvre lui aurait facilement valu une exposition individuelle à la Biennale, mais l’occasion devait se partager, une décision qui témoigne de la solidarité entre les architectes autochtones. Le fait de rassembler des architectes autochtones de toute l’Île de la Tortue constitue une affirmation politique en soi. Les liens autochtones sur l’Île de la Tortue dépassent les frontières des gouvernements canadiens ou américains. Outre Douglas Cardinal, seize autres architectes figurent dans le projet : Tamarah Begay (Navajo), Harriet Burdett-Moulton (Métis), Jake Chakasim (Cri), Chris Cornelius (Oneida), Wanda Dalla Costa (Crie), Tammy Eagle Bull (Lakota), Ryan Gorrie (Anishinaabe), Daniel Glenn (Crow), Ray Gosselin (Dakota, Métis, et Allemande), Matthew Hickey (Mohawk), Brian Porter (Oneida), Ouri Scott (Déné), Eladia Smoke (Anishinaabe), Patrick Stewart (Nisga’a), David Thomas (Anishinaabe) et Alfred Waugh (Déné).
L’installation correspond en tous points au style de Douglas Cardinal. Elle se déploie dans l’espace, fidèle à sa marque de commerce, oscillant à travers le temps comme la terre sculptée par le vent ou balayée comme une ancienne rivière endormie. À l’entrée, une vidéo de l’Aînée Jane Chartrand de Kitigan Zibi, nous accueille. Elle représente le Grandmothers Council (Conseil des grand-mères) et exprime cette responsabilité en soulignant que « les Aîné·e·s doivent guider en douceur, pour nous mener à une clarté de cœur et d’esprit, en lien avec la terre. » Chartrand reconnaît les éléments naturels et nous accueille dans ce lieu avec bienveillance. Ce geste, comme une invitation à se poser pour mieux entrer dans l’installation s’apparente à une « Bienvenue dans le territoire », tout en respectant notre statut de visiteur·euse·s en sol italien. L’installation se déploie ensuite en quatre principaux espaces d’une grande richesse médiatique avec de nombreux écrans qui diffusent du contenu tout au long de l’installation. Une intention et un but animent chaque élément : pour le commissaire, cette exposition devait refléter la multiplicité des vies, des cultures et des pratiques architecturales représentées dans le cadre de l’exposition. Dans le premier espace, on découvre le Dr Douglas Cardinal et un échantillon de sa carrière prolifique. Les surfaces voguent et les alcôves proposent des projections médiatiques accompagnées de haut-parleurs qui relaient des récits personnels imprégnés de culture. On peine parfois à entendre le contenu, mais dans chaque espace, des lieux précis sont conçus pour une écoute intime. Sur l’un des écrans, on assiste à la consultation communautaire pour le projet de l’Université des Premières Nations du Canada à Regina. La consultation a eu une influence déterminante sur la conception finale de l’Université, car les Aîné·e·s locaux ont proposé une vision convaincante, notamment avec le souhait de disposer d’un espace central sacré où organiser des cérémonies, recevoir le corps étudiant et accueillir la communauté. Les schémas ont intégré l’emblématique mîkiwahp (tipi), afin de réaffirmer la valeur culturelle de cet espace sacré. Le résultat final se traduit par une facture internationalement reconnaissable pour la façade de l’Université. Au fur et à mesure qu’on avance dans l’installation UNCEDED, on se familiarise avec les autres architectes et on constate des références historiques aux répercussions de la colonisation sur les Peuples autochtones de l’Île de la Tortue. Les écrans relaient les graves réalités de la colonisation et de l’Église catholique. Par exemple, on y apprend qu’en 1491, « la population autochtone sur l’Île de la Tortue s’élevait à dix millions de personnes » et qu’en 1493, « le pape a publié un édit décrétant que “les sauvages n’avaient pas d’âme et qu’ils pouvaient être tués” ». De 1492 à 1900, « neuf millions de personnes autochtones ont péri à la suite de maladies étrangères et de violents conflits coloniaux. » Le fait de nous trouver en Italie accroît la charge émotionnelle de ces affirmations. L’installation serpente doucement et se termine dans une salle circulaire cérémonielle abstraite, où un banc encourage la contemplation et la réflexion du public sur le contenu des derniers écrans.
Le son transmis dans l’espace fait vibrer des cordes sensibles et accentue l’expérience sensorielle. Entendre les voix de nos Premiers Peuples raconter leurs propres histoires, entendre des chants sacrés et le battement du tambour, qui fait surgir la mémoire musculaire de la danse, revêt une grande puissance. Dans ce pays lointain, cette Mecque occidentale où le grand art jouit d’une estime inégalée, et où la scène internationale présente des œuvres accueillies par l’élite intellectuelle, le contexte est d’une importance capitale. Quel rapport les personnes autochtones entretiennent-elles avec la Biennale de Venise, et pourquoi venir y présenter? Cette question alimente les conversations au sein de la communauté artistique autochtone depuis des dizaines d’années. « Venice, Love it or Leave it » (Venise, on aime ou on abandonne) était une table ronde organisée et animée par Ryan Rice dans le cadre du colloque 2007 du Collectif des commissaires autochtones, organisé à Saskatoon par Tribe Inc, un centre de développement des médias, des arts visuels et des arts de la scène autochtones. La question était la suivante : « La scène internationale est-elle le lieu où les artistes et les commissaires autochtones aspirent à s’imposer? En fin de compte, cela fait-il une différence et quels sont les bénéfices d’une telle représentation? » La conversation a donné lieu à une discussion animée avec les personnes qui ont déjà présenté à l’internationale. Le Dr Gerald McMaster a eu l’honneur d’être le commissaire d’une installation créée par Edward Poitras, le tout premier artiste autochtone à représenter le Canada à la Biennale d’art contemporain de Venise en 1995. Une déclaration de McMaster s’est démarquée : la posture politique d’une personne n’a pas d’importance sur la scène internationale, l’œuvre doit être provocatrice et d’une facture formelle, sa puissance doit la faire se démarquer du lot.
McMaster admet que les choses ont beaucoup changé depuis 1995, et les raisons de continuer à participer restent légitimes. À la Biennale de Venise de 1995, il n’y avait pas de public autochtone apparent; notre participation à la conversation mondiale commençait à peine, et la réaction des médias au projet d’Edward Potrias s’était avérée insuffisante. Depuis, de nombreuses délégations de commissaires autochtones se sont rendues à diverses biennales internationales, et les artistes autochtones participent de plus en plus à ces expositions critiques de masse. Quelques artistes, commissaires et architectes autochtones jouissent aujourd’hui d’une véritable renommée et, par conséquent, nos idées politiques ou nos récits gagnent aussi du terrain. Cependant, le chemin à parcourir est encore long. Nos esprits créatifs autochtones ont encore besoin de soutien et d’action. Leur représentation doit être accrue dans tous les espaces du milieu – dans les galeries, ainsi qu’à des postes de direction influents dans les principales institutions d’art et de design – de façon à refléter notre rôle et notre rapport essentiels au territoire, ainsi que notre souveraineté politique.
Si l’on considère la démarche commissariale du projet pour la Biennale de Venise en 2018, McMaster indique que la vision d’UNCEDED a occupé une place centrale, dès le début. Les architectes de l’équipe ont rassemblé et considéré les points d’entrée dans l’architecture contemporaine autochtone. Tous les membres de l’équipe respectent et admirent Douglas Cardinal, qui a animé la conversation initiale à l’Université OCAD. La discussion a commencé par une riposte aux pensionnats et aux écoles industrielles sur l’Île de la Tortue, qui, malheureusement, continuent de nuire à nos cultures de façon dramatique. Les populations autochtones ressentent encore les effets des tentatives d’assimilation et d’institutionnalisation dont elles ont fait l’objet. On ne peut nier les effets de la colonisation lorsque l’on considère l’histoire de nos designs. Les interactions avec la Couronne ont créé des obstacles pour les personnes autochtones sur le plan social et politique, ont nui à nos économies, à nos liens avec les autres êtres vivants, à nos langues et à nos territoires traditionnels. Malgré tout, nous n’avons pas renoncé à nos valeurs fondamentales, nous nous accrochons à notre souveraineté. C’est cette réplique aux structures institutionnelles qui a motivé UNCEDED. Cela nous amène à réfléchir et à nous projeter dans une vision d’ensemble. Quatre thèmes majeurs ont guidé le projet : les conséquences de la colonisation; la résilience, qui a permis aux Peuples autochtones de surmonter le poids écrasant de l’assimilation; la souveraineté, qui nous permet de conserver nos territoires et nos modes de vie ancestraux; et l’autochtonie, qui soutient notre destin grâce à la continuité culturelle et qui alimente les Futurités autochtones. En fin de compte, la démarche a reposé sur des choix qui reflètent les valeurs autochtones, en tenant compte de notre communauté, de l’histoire autochtone, de nos territoires et de notre manière de vivre à l’heure actuelle. L’exposition traite de la langue, de l’histoire et des cérémonies, articulées autour d’un nouvel ensemble de principes de design décrits sur un panneau explicatif à l’entrée de l’installation. Le commissaire et architecte David Fortin ajoute que l’architecture autochtone ne s’oriente pas autour d’objets, mais que la structure se manifeste à travers nos expériences ancestrales et nos formes de savoir. Inspiré par ces notions, UNCEDED vise à soutenir l’histoire des relations, à offrir un aperçu des approches des Premiers Peuples de l’Île de la Tortue au territoire, aux éléments naturels et à l’ensemble de nos liens. Tout sert à relier, créer ou construire l’espace : nos intentions, les sons, les gestes, les liens qui s’entremêlent dans le temps et nos engagements envers nos relations qui, à leur tour, informent notre complexe vision du monde autochtone. Il existe un fil conducteur, et le fondement ou le cadre de la culture autochtone est l’architecture elle-même.
Jason Baerg (Métis) est un artiste visuel et professeur adjoint à la Faculté des arts de l’Université OCAD.

As a master-builder, Douglas Cardinal’s life is dedicated to creating beautiful, thriving, and harmoniously built environments. His architecture springs from his observation of Nature and its understanding that everything works seamlessly together. His work has defined contemporary Canadian, Indigenous, and organic architecture. Throughout his career, Mr. Cardinal has been a forerunner in philosophies of sustainability, green buildings, and ecologically designed community planning.
Born in 1934 in Calgary, Alberta, his architectural studies at the University of British Columbia took him to Austin, Texas, where he received his architectural degree and found a life experience in human-rights initiatives. Mr. Cardinal then became a forerunner of philosophies of sustainability, green buildings and ecologically designed community planning.
In recognition of his work, Mr. Cardinal has received many national and international awards, including 20 Honorary Doctorates, Gold Medals of Architecture in both Canada and Russia, and an award from United Nations Educational Scientific and Cultural organization (UNESCO) for best sustainable village. He was also made an Officer of the Order of Canada — one of Canada’s highest civilian honours — and was named a “World Master of Contemporary Architecture” by the International Association of Architects.
Douglas Cardinal is one of the visionaries of a new world — a world where beauty, balance and harmony thrive, where client, architect, and stakeholder build together with a common vision.
Raised in the Canadian prairies, David Fortin is a Métis architect and academic with special interests in the relationship between design culture and Indigenous peoples, as well as speculative architecture — including Indigenous and non-Indigenous science fiction, and the projected impacts of climate change. He has worked for a number of leading design firms in Calgary, gaining experience on projects of various scales.
Since 2005, he has taught architecture in the U.K., the U.S. and Canada, leading undergraduate and graduate courses in architectural design, history and theory. He is currently completing a research project funded by the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), exploring prairie Métis contributions to architectural thinking in Canada. He has taught design studios and courses, working with various First Nations communities in Canada, the Northern Cheyenne in the U.S., and Indigenous communities in rural Kenya. In all these cases, design is explored in terms of its cultural relevance and long-term benefit to the community, as well as how contemporary technologies and systems can further support this.
Mr. Fortin is a member of the Métis Nation of Ontario, the RAIC Indigenous Task Force and is the first Indigenous architect to become director of a Canadian school of architecture.
Curator, artist, author, and Tier 1 Canada Research Chair in Indigenous Visual Culture and Curatorial Practice at OCAD University — Gerald McMaster has more than 30 years of international work and expertise in contemporary art, critical theory, museology and Indigenous aesthetics.
His experience as an artist and curator in art and ethnology museums has given him a thorough understanding of transnational Indigenous visual culture and curatorial practice. Throughout his career, his championing of the mainstream value of Indigenous art, among other things, has led to his being chosen to represent Canada at prestigious international events. These include his serving as Canadian Curator for the 1995 Venice Biennale, and more recently as artistic director of the 2012 Biennale of Sydney.
Mr. McMaster is Plains Cree and a member of the Siksika First Nation. Widely published, his awards and recognitions include the 2001 International Council of Museums (ICOM) -Canada Prize for contributions to national and international museology. In 2005, his country gave him its highest civilian honour, when he was named an Officer of the Order of Canada.
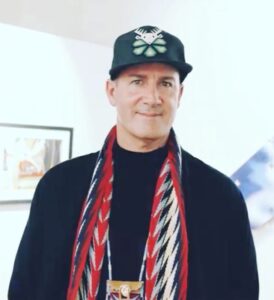
Jason Baerg is a registered member of the Métis Nations of Ontario and serves their community as an Indigenous activist, curator, educator, and interdisciplinary artist. Baerg graduated from Concordia University with a Bachelor of Fine Arts and a Master of Fine Arts from Rutgers University and is enrolled in the Ph.D. program at Monash University. Baerg teaches as the Assistant Professor in Indigenous Practices in Contemporary Painting and Media Art at OCAD University. Exemplifying their commitment to community, they co-founded The Shushkitew Collective and The Métis Artist Collective. Baerg has served as volunteer Chair for such organizations as the Indigenous Curatorial Collective and the National Indigenous Media Arts Coalition. As a visual artist, they push digital interventions in drawing, painting, and new media installation.