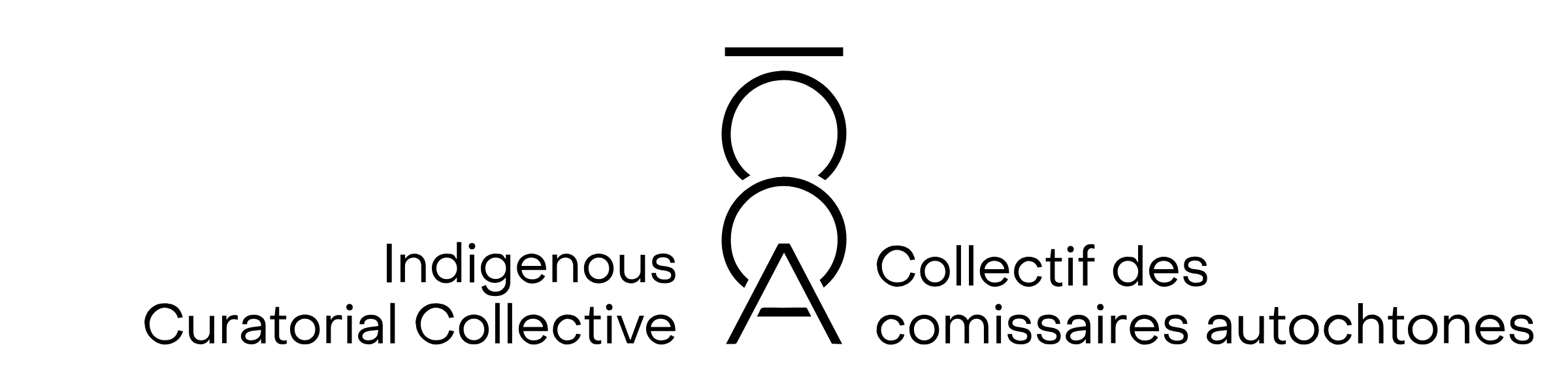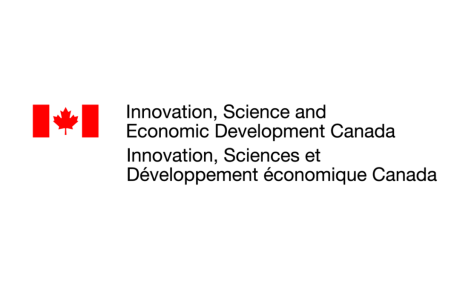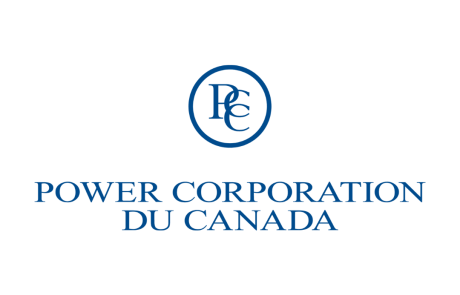Se tourner vers l’intérieur
Une collection de Réponses à la série de conversations Enjeux sur l’art, le commissariat et les soins communautaires

En 2021, l’ICCA a organisé quatre tables rondes en espaces fermés pour les communautés autochtones qui sont souvent négligées dans le discours national sur les arts autochtones, le commissariat et les soins communautaires. La série « Enjeux sur… » explore les nuances et le pluralisme au sein des membres de l’ICCA ainsi que la diversité au sein des communautés autochtones à travers ce qui est actuellement connu comme le Canada, mettant en lumière les voix Afro-Autochtones, nordiques, francophones, queer et DeuxEsprits. Vous pouvez regarder les tables rondes sur notre compte Vimeo en cliquant sur le lien ici Les transcriptions sont disponibles sur demande.
Six mois après la tenue des tables rondes, la Mackenzie Art Gallery a généreusement fait don de fonds financier à l’ICCA pour soutenir la poursuite de la série « Enjeux sur… », permettant à des artistes et auteur.trices de ces mêmes communautés de créer de nouvelles œuvres en réponse aux discussions.
Veuillez trouver ci-dessous six fantastiques réponses créées par Cheyenne Wyzzard-Jones, Paige Pettibon, Darcie Bernhardt, Aïcha Bastien-N’Diaye, Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo, and Adrienne Huard.
Perspectives Noires et Autochtones
Réponses à la première conversation sur les perspectives Noires & Autochtones de la série Enjeux sur l’art, le commissariat et les soins communautaires avec les participant.e.s Nenookaasi, Shanese Anne Indoowaaboo Steele, Aria Evans, kaya joan, Teineisha Richards et Lena Farrell.
Réponses par Paige Pettibon et Cheyenne Wyzzard-Jones ci-dessous.
Paige Pettibon
Work of Healing

Paige Pettibon
Paige Pettibon est une artiste basée à Tacoma, Washington. Elle travaille principalement avec la peinture acrylique mais elle explore aussi la fibre, le perlage, la conception numérique et d’autres médias. Paige est Noire, blanche et Salish (des nations confédérées Salish et Kootenai). Paige est influencée par son passé multiculturel. Elle s’identifie comme une artiste communautaire. Elle continue de grandir au sein de la communauté autochtone en apprenant la langue Lushootseed, les chants tribaux, les arts, les danses et les traditions. Quelques-uns des ses projets qui la tiennent occupée au jour le jour sont sa petite entreprise de bijoux intitulée Plain to Sea ainsi que son contrat avec le département de développement des programmes de l’école Muckleshoot Tribal afin de créer des images graphiques spécifiques axées sur les plantes autochtones, les animaux, et le travail social et émotionnel. Elle enseigne aussi la langue Lushootseed pour l’Institut multilingue en ligne. Paige fait partie de la cohorte de l’organisation Yehaw’ Show et contribue aux efforts de l’administration pour donner la priorité à l’art et aux artistes Autochtones dans les espaces publics. Elle a travaillé avec le Smithsonian, Nia Tero’s Reciprocity Project, Starbucks, North Seattle College, Tacoma Community College, City Tacoma’s Art Commission, MadArt Gallery, Stonington Gallery, Tacoma Art Museum, Puyallup Tribal Language Department et quelques autres communautés du nord-ouest du Pacifique. Ses bijoux sont visibles sur Instagram @plain_to_sea et son art @Paige_Pettibon Son site web est PaigePettibon.com
Cheyenne Wyzzard-Jones
Réflexion
Les personnes Noir.e.s Autochtones existent dans l’entre-deux. Nous existons dans un monde qui ne comprend pas, n’apprécie pas ou ne reconnaît pas notre existence. On nous dit que nous devons être « cent pour cent » de sang Autochtone pour revendiquer l’indigénéité, une pratique d’effacement colonial. On nous dit que si vous avez une goutte de “sang Noir” dans votre corps, vous pouvez vous attendre à faire face à la violence anti-Noir et de l’hyper-visibilité, à moins que vous ne soyez assez pâle pour être “accepté”. Nos réalités racontent à la fois des histoires d’effacement violent et d’exposition marchande. La violence systémique coloniale latérale a utilisé nos corps, source de notre forme d’art ancestrale, pour dicter notre récit. Cependant, des panels tels que celui organisé par le Collectif des commissaires autochtones – un rassemblement intergénérationnel de six artistes Noir.e.s et Autochtones – reflètent non seulement pourquoi nos histoires sont importantes, mais comment nous avons toujours créé, manifesté et pratiqué l’art et les soins communautaires comme un moyen de durabilité. Lorsque nous parlons d’Autochtonie Noire, comme l’a mentionné Shanese Anne Indoowaaboo Steele dans le panel, il est important de comprendre que l’autochtonie n’est pas exclusive aux personnes qui ne sont pas Noir.e.s. Il y a des Autochtones qui sont Noir.e.s non pas parce qu’iels sont métissé, mais parce qu’il existe un monde où Noir.e.s et Autochtones existent en simultanés. Il y a aussi nos parents métissés, qui sont Noir.e.s et Autochtones en raison d’une longue histoire commune de familles Autochtones Noires et non Noires qui s’aiment, prennent soin et sont solidaires les un.e.s des autres. En tant qu’Autochtone Noir enraciné dans ma famille côtière ancestrale de baleiniers, qui a ensuite créé une famille avec les Nations Nipmuc et Wampanoag, j’ai apprécié qu’Aria Evans partage l’histoire de la traite des esclaves en Nouvelle-Écosse. Écouter l’Aînée « Mama » Lena Farell parler de la solitude des Aîné.e.s en Nouvelle-Écosse, s’identifier comme l’une des seules personnes de sa communauté à avoir suivi le rituel traditionnel pour recevoir l’honneur d’Aînée et énoncer les conséquences réelles de la violence coloniale dans nos communautés Autochtones et Noires. Cela témoigne également de ce que de nombreux panélistes ont partagé concernant les nombreuses façons dont nous traçons notre propre chemin à la fois dans notre carrière artistique et dans nos réseaux communautaires.
En tant qu’artistes, commissaires et personnes qui désirent exister dans un lieu où tout le monde est reconnu, nous devons être capables d’élargir nos esprits et nos pratiques au-delà d’un seul récit de race et d’ethnicité. Quelles histoires faisons-nous taire ? Qu’est-ce que cela signifie vraiment que les vies des personnes Noir.e.s comptent ? Et qui nous tient redevable de notre responsabilité de combler les lacunes de notre imagination sociétale collective ? Shanese a dit une vérité à laquelle je crois, beaucoup d’artistes Autochtones Noir.e.s sont confrontés : le fait que les gens s’intéressent soit à une perspective Autochtone, soit à une perspective Noire, mais rarement aux deux. Et lorsque nous partageons la réalité des deux, nous sommes vulnérables à une vague de racisme anti-Noir ou anti-Autochtone tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos communautés. Ce qui signifie que toute prise en charge communautaire doit centrer la question : où les Autochtones Noir.e.s se sentent-iels en sécurité ? La sécurité fait référence à un sentiment d’appartenance, un sentiment compris dans la tête, le corps et l’esprit. Cependant, comme mentionné dans le panel, les Autochtones Noir.e.s sont confrontés à une violence spécifique lorsqu’iels se demandent « Suis-je assez ? ». Aria a parlé de ce sujet lorsqu’elle a expliqué que convaincre les gens qu’iels n’appartiennent pas à leurs propres communautés et groupes culturels est un outil efficace de colonisation. « C’est une méthode de séparation dont nous avons été témoins comme une tactique répétitive de la part des colonisateurs. » J’ai apprécié la conversation sur le colonialisme car être Noir.e sur l’Île de la Tortue informe une perspective sceptique sur la réconciliation. La réalité est que pendant que les Noir.e.s se battent pour être considérés comme des contributeur.trice.s dans un pays que nous avons construit, le problème fondamental est perçu comme moins qu’humain. Il y a un cycle continu de marchandisation des corps Noirs pour une économie colonisée. Il est également important de mentionner ici que cette réflexion sur les perspectives des Autochtones Noir.e.s sur le colonialisme est un tout autre sujet en soi. Je mentionne cela parce que lorsque l’on discute de problèmes au sein de l’industrie de l’art et de l’organisation communautaire, la question de savoir d’où nous recevons les ressources et quels compromis nous faisons pour les recevoir est remise en question. C’est encore une question de savoir qui est valorisé et qui est ignoré.
Comme tout groupe racial ou ethnique, les peuples Autochtones Noirs n’existent pas au sein d’un monolithe. Nos expériences sont vastes et complexes. Il est également important de noter que ce que j’ai apprécié dans ce panel, c’est que plusieurs panélistes se sont identifiés comme des personnes queer, non binaires et/ou deux esprits/identités multiples. Cela a apporté sa propre singularité à la façon dont les panélistes appréhendent leur réalité au sein de leurs communautés et de leurs pratiques artistiques. En tant que personne queer qui utilise les pronoms elle/iel, je veux mentionner l’importance de la réponse de Kaya Joan quand iel a affirmé qu’iel voit son travail comme un espace de réclamation, d’abondance et de joie. Cela ressemble à la raison la plus queer, la plus Noire et la plus Autochtone de créer de l’art que je pourrais demander. Au sein de ma propre identité queer, j’ai vu mon indigénéité être synonyme de ma pratique et de mes rituels avec la terre, mon corps et ma communauté. C’est celui qui ne voit pas les êtres spirituels, la Terre, et celleux qui l’ont administrée, dans une binarité. J’ai expliqué cela dans l’un de mes premiers écrits sur l’indigénéité Noire que “mon sexe est Noir”. J’ai mentionné : « Déclarer que c’est un acte de compréhension comment le colonialisme et l’esclavage ont déshumanisé les expressions de genre des Noir.e.s [et des Autochtones] comme ” toujours mal faite, faite de manière dysfonctionnelle, faite d’une manière qui n’est pas normale”. Déclarer [mon genre est Noir] est de comprendre que faire la police à propos de qui est Noir.e et les identités de genres sont interconnectés.” Par conséquent, pour l’art Autochtone Noir d’être représenté comme un espace de réclamation et un espace de partage d’une vérité abondante, est un acte radical. J’espère que nous pourrons créer plus d’espaces pour que les récits Autochtones Noirs soient partagés, valorisés et honorés d’une manière qui fait avancer notre monde vers une véritable libération. L’art est un moyen de transformer les cultures et les consciences, et nous devons centrer les plus vulnérables et les plus négligés si nous croyons vraiment que créer et commissarier de l’art peut être un acte politique radical.
Cheyenne Wyzzard-Jones
Cheyenne est co-fondateur.trice du collectif In Solidarity (précédemment Women of Color in Solidarity) et créateur.trice artistique pour Spiritual is Political. À travers les médiums de l’éducation radicale, l’organisation communautaire et l’art, Cheyenne explore l’étendue de la construction de la liberté. Iel est basé sur le territoire Lenape à Philadelphie, PA, et a organisé plusieurs projets à travers les États-Unis, le Canada et les Caraïbes depuis plus de 10 ans. Son travail est profondément ancré et informé par les pensées et les pratiques des féministes Noires Autochtones queer. Son travail est enraciné dans des technologies qui perturbent les structures dominantes patriarcales blanches du temps, des genres, de frontières et de systèmes de punition qui ont altéré l’ordre naturel. Son travail a été présenté sur TEDx, The Void Academy, CRWN Magazine, Medium Magazine et The Queens Museum.
Perspectives Nordiques
Réponse par Darcie Bernhardt pour la conversation sur les perspectives nordiques de la série Enjeux sur l’art, le commissariat et les soins communautaires avec les participant.e.s Ossie Michelin, Taqralik Partridge, Teresa Vander Meer-Chassé, Bryan Winters, Jessica Kotierk, l’Aînée Naulaq LeDrew et Tamika Knutson
Darcie Bernhardt
Les souliers de Jijuu
La mémoire a un énorme impact sur ma pratique et mon inspiration en tant que moyen de préservation décoloniale. Je n’arrêtais pas de penser à la façon dont quitter ma communauté et se souvenir des modèles de pantoufles m’ont été transmis. Laisser une empreinte et réapprendre à faire des motifs floraux est quelque chose qui m’a permis de me reconnecter à chez moi. Ce que j’ai retenu de la table ronde sur les Perspectives Nordiques a été d’entendre et de me souvenir d’être en communauté avec les personnes Inuits et Autochtones.
La série d’œuvres Les souliers de Jijuu inclut 9 petits dessins et un court vidéo par Darcie Bernhardt. Les dessins sont des motifs floraux utilisés pour des modèles de pantoufles. Chaque série de dessins incluent un dessin du tracage du motif floral avec un crayon noir, un dessin de tracage du motif floral avec des crayons de couleurs par dessus le crayon noir et un dessin du motif floral avec le remplissage de couleurs. Les trois types de motifs floraux incluent une fleur rouge foncé et pâle avec des feuilles vertes; une fleur rouge foncé, avec un peu de bleu et mauve dans les pétales et des feuilles vertes et jaunes; et une fleur bleu foncé et pâle avec des feuilles vertes. Le vidéo est d’une durée de 12 secondes. On y voit le petit cahier de dessin de Darcie et iel tourne quelques pages du cahier avec ses mains. Il y a un dessin de fleur sur chaque page.









Darcie Bernhardt
Darcie « Ouiyaghasiak » Bernhardt est un.e artiste Inuvialuk/Gwichin de Tuktuyaaqtuuq, NT, Alumna de NSCADU en 2019 (Baccalauréat). Élevé à Tuktoyaktuk, là où les vents violents de l’océan sillonnent le paysage de l’ouest de l’Arctique, Bernhardt a un lien spécial créé à partir de cet écosystème avec sa famille et son sens du territoire. Sa pratique s’est principalement concentrée sur le récit de la vie domestique dans le Nord à partir des souvenirs de la maison. Sa première exposition solo de peinture intitulée Akisuktuaq a été présentée à la galerie Feheley Fine Art en juin 2021. Iel faisait partie de EVERYSEEKER’s Call + Response où iel a créé une animation vidéo et collaboré avec Sill and Rise single Pandemonium pour leur prochain album. Bernhardt était une artiste vedette de la Inuit Art Foundation et a présenté Nanuk et Jijuu à Art Toronto en octobre 2019. Le travail de Bernhardt a été présenté à Nuit Blanche (Montréal, 2019) dans le cadre de la résidence Memory Keepers I de GLAM Collective, et iel a été assistant.e commissaire pour Memory Keepers II à Art in the Open (Charlottetown, 2019). Ses courts métrages collaboratifs ont été présentés à ImagineNATIVE (Toronto, 2020), Maoriland Film Festival (Nouvelle-Zélande, 2021) et BIRRARANGGA Film Festival (Australie, 2021) pour Greed Story. Son film en collaboration avec Carmel Farahbakhsh intitulé Nanuk & Bibi a été présenté à Nocturne (Halifax, 2020) et au Festival du Court Métrage de Toronto (mars 2021). Iel a fait partie des projets d’artistes émergent.e.s de RBC. L’année dernière, iel a reçu la reconnaissance d’artiste Autochtone d’Arts Nova Scotia (2020). Plus récemment, son travail peut être vu dans INUA, l’exposition inaugurale à Qaumajuq, le nouveau Centre d’art Inuit de la Winnipeg Art Gallery (2020-2021).
Perspectives francophones
Réponses par Aïcha Bastien-N’Diaye et Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo à la conversation perspectives francophones de la série Enjeux sur l’art, le commissariat et les soins communautaires avec les participant.e.s Caroline Monnet, Marie-Lee Singoorie, Simon M. Benedict et notre Directeur.trice de la programmation, Camille Larivée.
Aïcha Bastien-N’Diaye
Performance de danse
Le mouvement me semble être un langage beaucoup plus accessible que la langue parlée ou écrite. Et donc souvent, quand je ne trouve pas les mots ou quand ils ne suffisent pas, je danse. Quand je veux m’assurer que le message passe, je danse. Quand j’ai besoin de me rappeler d’où je viens pour savoir où je vais, je danse. Comme mes ancêtres l’ont fait avant moi, et ce, peu importe la langue qu’iels parlaient.
Peu importe la langue qu’iels parlent.
Mon corps est résistance, mon art est un médium de changement, ma danse est une révolution.
Il faut que ça brasse.
Description du vidéo : Une vidéo d’une durée de 3 minutes et 59secondes. Aïcha récite un texte au début de la vidéo. Par la suite, Aïcha commence à danser sur du gazon entouré d’arbres sur le morceau musical 32.22 de Childish Gambino. Elle porte un grand chandail à capuchon noir et des pantalons noirs. Il y a des longues franges de plusieurs couleurs qui pendent de chaque côté de son chandail et qui bougent dans le vent. Par la suite, Aïcha continue de danser avec les mêmes vêtements et en arrière-plan il y a un grand lac et des montagnes. Par la suite, Aïcha danse sur le gazon. Le vidéo se termine alors qu’Aïcha regarde la caméra.
Paroles du texte récité par Aïcha dans le vidéo :
“ Endormie ou réveillée, je rêve tout le temps. Je rêve souvent d’un monde meilleur. D’un endroit où le partage de nos expressions artistiques ne serait pas limité par la langue, dans les boîtes dans lesquelles ont devrait fitter. Par notre apparence. Par les préjugés et les clichés qui nous précèdent. Je rêve d’un monde où la diversité serait considérée comme une richesse et une force, de par nous rassembler plutôt que nous diviser. Je rêve d’un chez-nous où on dirait Skoden et Stoodis davantage que “Okay but, could you do it in English? I just want to make sure that everybody gets it.” Je rêve que le mouvement suffise. Je rêve que ça brasse. Je m’arrange pour que ça brasse. “
Habillement : Grégoire Maisonneuve
Musique : 32.22 par Childish Gambino
Aïcha Bastien-N’Diaye
De la nation Huronne-Wendat, Aïcha est initiée au mouvement par la danse traditionnelle de la Guinée tout en grandissant sur le territoire de la communauté de Wendake. Créant instinctivement un mélange homogène entre deux fortes cultures, son engouement pour la physicalité et l’expressivité de la danse la guidera vers la formation professionnelle de L’École de danse de Québec. Créant des unions entre différents styles de danse et d’expression, elle présente l’art chorégraphique en abolissant frontières et stéréotypes. Artiste en danse, productrice de contenu, militante et adepte des mots, Aïcha considère l’art comme un médium proactif pour générer changements et réflexions. Quoi de mieux que d’orchestrer une symphonie corporelle pour combattre l’ignorance ?
Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo
Conversation avec Johnny Boivin : Perspective Autochtone sur la préservation de la langue française au Québec

Lors d’une soirée ensoleillée de juin accompagnée d’un doux vent frais, le conseil jeunesse de l’organisme Montréal Autochtone se rencontre pour la première fois en personne depuis plus d’un an au Parc Lafontaine. Il y a un certain réconfort d’être enfin réuni et ce, à l’ombre d’un arbre et autour de cheeseburgers.
Une discussion débute sur les langues. Plus précisément sur les langues au Québec et comment cela affecte la jeunesse actuelle et l’impact de la protection de la langue française sur la représentation des différentes cultures. Cette discussion soulève des points qui valent la peine d’être partagés. Aujourd’hui, c’est Johnny Boivin qui prend la parole concernant la préservation de la langue française au Québec et les impacts que cela a eu sur sa vie.
Johnny est membre du conseil jeunesse de Montréal Autochtone depuis 2019. Faire partie de ce groupe travaillant au rayonnement de la jeunesse autochtone à Montréal l’a grandement aidé, notamment en se démarquant en tant qu’artiste visuel, mais aussi en créant des espaces sécuritaires pour la jeunesse autochtone.
Comment aimerais-tu être introduit ?
D’habitude je me présente en tant qu’artiste. Parce que c’est ce que je fais et ensuite, je dis que je suis Atikamekw et Innu.
On dirait que je tombe dans une autre crise identitaire. Je ne sais pas quoi faire avec mon côté québécois. Depuis deux, trois ans, je m’identifie juste comme Atikamekw et Innu. Même si je suis québécois aussi. Je vois tout le monde qui disent qu’iels sont québécois.es et là je me demande si je devrais le faire ou non. J’ai tu l’air de mentir si je ne le fais pas ?
Quelles sont les langues qui forment ton identité ? Te considères-tu plus anglophone ou francophone ?
Très jeune, ma mère a commencé à m’apprendre l’anglais. Mais je n’en ai pas eu besoin jusqu’à temps que je commence à naviguer sur les réseaux sociaux où j’ai rencontré ma femme, Tara.
J’ai commencé à fonctionner et penser davantage en anglais. Quand elle a déménagé ici, on n’écoutait plus la télé d’ici, tout était «switché» en anglais. Je suis devenu anglophone d’une certaine façon parce que pour elle c’était plus facile pour communiquer. Quand je me réveille le matin, ma première langue c’est l’anglais. On dirait que j’ai comme changé de première langue.
J’ai toujours dit que j’étais bilingue. Pour être honnête, quand vient le temps d’écrire dans l’une ou l’autre langue, je ne sais jamais laquelle choisir. D’une certaine façon, on dirait que j’ai plus de facilité en anglais qu’en français. Techniquement, je suis francophone, alors je ne sais jamais quoi mettre.
Quelles langues utilises-tu sur les médias sociaux ?
Sur mes pages personnelles, c’est majoritairement en anglais avec du français quelquefois. Mais pour ma page d’art, j’y vais en anglais parce qu’il y a une plus grande couverture en anglais. Ça ne te limite pas juste à vendre à un public francophone. Ça va rejoindre tout le monde.
Quel est ton avis sur la préservation de la langue française ?
Personnellement, j’aime les langues. Mais d’un point de vue artistique, j’aime certains poèmes en français parce que certains mots en français évoquent des choses que tu ne peux pas traduire. Même chose en anglais.
Je pense qu’un des meilleurs exemples, c’est Fred Pellerin. Il invente des mots que tu ne peux pas traduire. Il joue avec la langue française et j’aime ça jouer avec la langue, et jouer avec les jeux de mots et les sonorités parce que ça me stimule. Alors le côté artistique des langues, c’est sûr que ça vient me toucher.
Mais j’ai jamais vraiment cru que la langue française est autant en danger que ça. Parce que j’ai l’impression que les québécois.e.s pensent que c’est juste ici et en France qu’on parle en français. Mais non. On parle en français dans le “reste du Canada”. On parle en français aux États-Unis, en Louisiane. On parle en français en Belgique, dans d’autres pays en Europe. La Martinique, les Caraïbes… Il y a tellement de pays dont le français est l’une de leurs langues officielles.
La langue n’est pas en train de mourir là. C’est juste qu’on évolue dans un monde où il y a plus de diversité. Si tu continues à parler en français à la maison, la langue est vivante.
Nous, notre génération, on est beaucoup plus bilingues. On parle et fonctionne quand même avec le français la plupart du temps. On ne perdra probablement jamais notre langue. Même si je déménage et que je ne parle plus français pendant dix ans, je ne vais pas perdre mon français.
Iels parlent de la «valorisation» du français mais je trouve que ce n’est pas le bon mot. On dirait qu’on remonte le français mais on enlève presque toutes les autres langues. Faut que ce soit juste le français. C’est pas comme ça que tu vas revitaliser une langue. C’est en la rendant accessible, oui, mais de façon accueillante. Pas en la forçant et en assimilant de façon déshumanisante comme j’ai pu le témoigner avec le système de l’immigration avec ma femme. C’est l’approche qui est utilisée. En tant que francophone, ça ne me donne même pas le goût de l’être quand je vois ça.
Que penses-tu de la représentation des différentes communautés francophones et autochtones dans les médias ?
Ce que j’ai remarqué quand vient le temps de la langue française, c’est que dès qu’on va sur une plateforme publique, il faut absolument avoir un certain degré de français.
Jemmy [Echaquan-Dubé] qui roule ses r ou Sipi [Flamand]… Iels ont des accents et pour beaucoup de gens, on dirait que ça dérange quand il y a des accents. On dirait que quand vient le temps d’avoir des opportunités plus professionnelles ou dans les médias, on s’en va plus vers ce qui est conforme, ce qu’on aime voir et ce qu’on aime entendre. On rentre dans des moules qui viennent fermer des portes à des opportunités justement pour les autochtones qui ont quelque chose à dire. C’est pour ça que je trouve que c’est tellement mieux dans nos rassemblements à nous où l’on peut prendre notre temps pour s’exprimer. Quand on fait le cercle de partage au début, on fait notre ouverture, on prend notre temps. Quand on cherche un mot, c’est correct.
Tu fais référence ici à ton expérience avec le conseil jeunesse de Montréal Autochtone. Est-ce qu’il y a une possibilité pour toi de faire partie d’autres conseils jeunesse ?
J’ai l’impression que je ne pourrais pas être dans un conseil jeunesse allochtone.
Avec «Ensemble sur le climat», qui était un programme ayant pour but de créer des espaces de partage et de discussions sur les enjeux environnementaux entre jeunes allochtones et Autochtones, on était tous.toutes un peu sur la même page. C’était plus facile. Je ne pourrais pas par contre être dans un groupe jeunesse à Verdun par exemple. Parce qu’on n’a pas les mêmes enjeux et on ne se comprend pas au même niveau. Culturellement, il y a des enjeux qui sont différents. On dirait que c’est plus facile d’être ensemble. On se comprend mieux entre nous. Dans nos accents et nos façons de parler.
Quand vient le temps de transposer ça au public, c’est là qu’on a des problèmes de «name dropping» ou c’est tout le temps les même personnes qu’on voit. Des gens qui deviennent les “porte-paroles” et on s’entend que ces personnalités publiques ont un très bon niveau de français.
Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes voix et qui ont quelque chose à dire. Ça vaudrait la peine de les écouter, mais à cause qu’iels n’ont pas le français qu’on aimerait entendre et qu’iels n’ont pas un ”bon parler”, iels vont manquer cette opportunité là, et c’est là que ça coupe des voix. C’est sûr que ça va affecter les artistes comme les musicien.ne.s et les artistes visuels. Iels n’ont peut-être pas la «bonne» façon de s’exprimer, mais ça n’enlève rien à leur travail.
Cette voix fait partie de tant d’autres et ne reflète qu’une seule réalité. Et c’est important de comprendre que chaque personne a une relation différente avec la langue française. Nous avons pu lire la réalité de Johnny Boivin aujourd’hui. Un gros merci pour son ouverture et sa confiance pour partager ses pensées et ses expériences personnelles. Tshinashkumitin.
Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo
Kijâtai vit à Montréal et est membre de la nation Anishnabe. La famille du côté de son père vient de la communauté du Lac-Simon et celle de sa mère, qui est franco-québécoise, vient de Val-d’Or. Ses courts métrages abordent les réalités autochtones de façon personnelle (Kijâtai, Kabak, Odehimin et Kimiwan). Iel s’engage également à travers les organismes autochtones tels que Puamun Meshkenu, Mikana et Wapikoni, ce qui lui permet d’œuvrer sur la création de ponts entre autochtones et allochtones, en plus de sensibiliser les gens aux différentes réalités autochtones. Iel a pu collaborer aussi avec le média d’actualité La Converse et la revue Relations en écrivant des articles sur différents sujets. Iel a débuté son BAC en communication (journalisme) à l’UQAM à l’automne 2021.
Perspectives Queer, Deux Esprits & minorité de genres
Réponse par Adrienne Huard pour la conversation perspectives Queer, Deux Esprits & minorité de genres de la série Enjeux sur l’art, le commissariat et les soins communautaires avec les participant.e.s Adrienne Huard, Ravyn Wngz, Keisha Erwin, Logan MacDonald, Ange Loft et l’Aîné.e Albert McLeod.
Adrienne Huard
Black Velvet
Description du vidéo
Adrienne Huard
Adrienne Huard (iel/ellui) est un·e commissaire, écrivain·e, universitaire et artiste de performance deux esprits anishinaabe. Iel est citoyen·ne de la Première Nation Couchiching en Ontario et a grandi à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada. Après avoir agi à titre de rédacteur·rice en chef de la revue Canadian Art, une publication nationale consacrée aux arts, iel a cofondé le collectif de commissaires gijiit en collaboration avec Jas M. Morgan. Iel poursuit actuellement ses recherches doctorales en études autochtones à l’Université du Manitoba.